Le Musée d’Art moderne de Paris accroche une rétrospective de l’œuvre de Nicolas de Staël avec un bon tiers d’œuvres qui n’ont jamais été montrées au public. Artiste d’importance majeure du siècle dernier, il demeure toutefois et étonnement encore peu connu du grand public. On y découvre une artiste entre abstraction et figuration développant un sens aigu de la couleur et qui sut se dégager de toute la doxa de son temps.
Exposition Nicolas de Staël au Musée d’Art moderne de Paris jusqu’au 21 janvier 2024

Vue d’une des salles de l’exposition avec des œuvres du voyage à Agriente de 1953 © Adagp, Paris 2023 / Ph.: D.R.
Fugue, 1951-1952 © The Phillips Collection, Washington, D.C. / ADAGP, Paris, 2023 / Ph.: W. Larrimore

Paysage, 1952 © Collection privée / Courtesy Applicat-Prazan, Paris / ADAGP, Paris, 2023

Femme assise, 1953 © Coll. part. / ADAGP, Paris, 2023 / Ph. : Jean-Louis Losi

Arbre rouge, 1953 © Coll. part. / ADAGP, Paris, 2023 / Ph. : Christie’s

Marseille, 1954 © Courtesy C. et N. Kairis / Courtesy Applicat-Prazan, Paris / ADAGP, Paris, 2023

Coin d’atelier sur fond bleu, 1955 © Paris Centre Pompidou / MNAM / ADAGP, Paris 2023 / Ph. :D.R.

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir
Connaît-on vraiment Nicolas de Staël (1914-1955) ? Ce peintre, l’un des plus grands du siècle dernier, s’il est connu et reconnu parmi certains, il reste toutefois peu connu pour beaucoup. On ne peut donc que saluer la tenue de cette exposition forte de 200 œuvres dont 30% n’ont peu, sinon jamais, été vues à Paris. C’est que nous propose le Musée d’Art moderne de Paris en cette fin d’année. Et Fabrice Hergott, directeur du musée, d’enfoncer le clou : « On se dit que l’on connaît, avant de croire connaître, puis de se rendre compte que l’on ne connaît pas ». Donc, même les connaisseurs seraient à reconquérir ! L’exposition tient largement cette promesse.
En son temps de l’abstraction triomphante, cette époque pendant laquelle les Soulages, Hartung, Barré, Schneider et autre Atlan forgent l’art de la seconde moitié du siècle, Nicolas de Staël, lui, s’immisce dans un entre-deux incluant des éléments figuratifs dans ses tableaux… des éléments, toutefois révélés ou décelables par le titre souvent (Femme assise, 1952). Cette gageure fait de Nicolas de Staël un peintre novateur et dont l’art cultive cette ambiguïté. Son travail sur la couleur cache aussi l’homme qu’il fut. Un homme empreint de doutes, partager entre un art difficile et une recherche de reconnaissance, qui se suicida par amour à l’âge de 41 ans ! Un artiste, dont le mythe, comme le souligne l’historien Pierre Watt, co-commissaire avec Charlotte Barat-Mabille, a eu tendance à occulter l’œuvre.
Depuis l’exposition du Centre Pompidou, il y a tout juste 20 ans, aucune exposition d’importance ne lui avait été consacrée, si on excepte un accrochage à l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence en 2018, consacré à ses œuvres « provençales ». C’est dire l’importance de la présentation au Musée d’Art moderne de Paris ! D’autant que les commissaires, aidés par les héritiers du peintre et certains marchands – dont Franck Prazan qui a présenté au marché ces dernières années les plus belles toiles du peintre – ont enquêté, recherchés et convaincus musées et collectionneurs privés de prêter, le temps de cette exposition, des chefs d’œuvres présentés ici. À l’image d’Agrigente, une œuvre magistrale de 1953, peint suite à un voyage en Sicile, accroché (et décroché pour l’occasion) dans le salon d’un collectionneur privé.
Mais peut-on détacher la vie tourmentée du peintre de son œuvre tant ceux-ci dans sont ici des plus intimement liées ? Et la biographie qui fait référence, celle de Laurent Greilsamer¹, dont le sous-titre de « prince foudroyé », renvoi non seulement à l’homme qu’il était, mais aussi à ses origines : celle du noble russe qu’il était de naissance contraint, avec sa famille, à l’exil. Une vie de déracinement, de doutes, de combats et d’amour.
Une famille en exil
De Staël est né baron le 23 décembre 1914 à Saint-Pétersbourg, de son patronyme complet : Nikolaï Vladimirovitch Staël von Holstein, d’une famille noble issue d’une lignée de militaires qui ont servi sous différents tsars. Son père, Vladimir Ivanovitch, est décrit

Eau-de-vie, 1948 © Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger /ADAGP, Paris, 2023 / Ph.: Georges Poncet
comme austère et sa mère, née Lioubov Berdnikova, de deux décennies plus jeune que son mari, est, elle aussi, issue d’une famille fortunée. Les Staël von Holstein, nobles et respectés, vivent dans un hôtel particulier sur la chic Perspective Nevski. Une aisance, un niveau social, une vie dans la haute bourgeoise qui va être balayée par la Révolution d’Octobre, qui contraint cette famille de « russes blancs », comme tant d’autres, à émigrer.
Ce sera d’abord la Pologne où ses parents décèdent, son père en 1920 et sa mère un an plus tard. Le jeune Nicolas, et ses deux sœurs Marina et Olga, devenus orphelins sont recueillis par une parente de leur mère qui les confie aux Fricero, une famille sardo-russe, qui dirigent une institution bruxelloise qui vient en aide aux enfants orphelins de l’aristocratie russe. C’est donc là, qu’il commence ses études. Curieux de tout, il entretient une passion pour les auteurs latins, mais aussi pour les poètes comme Baudelaire ou Verlaine. Il lit beaucoup, écrit tout autant, mais surtout, dès son plus jeune âge, il va découvrir, dans les musées et galeries alentours, autant les grands peintres de l’âge d’or des Écoles du Nord que l’art belge de son temps.

Parc des Princes, 1952 © Coll. part. / ADAGP, Paris, 2023 / Photo Christie’s
« Enfant, il entraînait avec autorité ses sœurs dans les galeries de peinture – relate Laurent Greilsamer¹ – il poussait la porte des marchands avec l’aisance d’un collectionneur et se plantait devant les toiles. ». En 1933, on le voit aux Beaux-Arts de Bruxelles puis à l’Académie de Saint-Gilles. Très vite, il élargit son champ de vision, en voyage, il semble vouloir dévorer le monde : les Pays-Bas, la France, l’Espagne tous les chefs d’œuvre qu’il découvre nourrissent son insatiable besoin de découvrir la peinture de son époque. « Je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine » écrit-il son tuteur et ami Fricero.
Au Maroc en 1937, il rencontre une certaine Jeannine Guillou qui quitte le Maroc pour lui. Peintre, elle avait étudié aux Arts Déco à Nice. Si Jeannine a déjà trouvé sa voie et son style, Nicolas lui a rêvé du Maroc comme Delacroix, Klee et Matisse avant lui. Il travaille d’arrache-pied ébloui par cette nature sauvage, ses habitants comme les villages et les monuments. « Trop à voir, trop à saisir. » Il croque les gamins, les paysages, les
animaux… Travaille des heures entières et cette expérimentation jamais délaissée sera la marque de son œuvre. Paris ! Évidemment, où il s’installe en 1938 au retour d’un voyage en Italie avec Jeannine. Ils resteront ensemble jusqu’à son décès à 36 ans en 1934, suite à un avortement thérapeutique. Paris, sonne un nouveau départ… Enfin, pas tout à fait. La Seconde Guerre mondiale stoppe un instant son élan. Apatride, il s’engage dans la Légion étrangère, mais est démobilisé moins d’un an après cette « drôle de guerre ».
Paris et premières expositions
Paris, c’est pour lui un changement artistique radical : il opte pour l’abstraction alors en vogue. Par l’entremise de César Domela, il rencontre Jeanne Bucher à la tête d’une des principales galeries de l’époque, découvreuse de Viera da Silva et d’Alberto Giacometti entre autres. Cette dernière inclut quelques-unes de ses œuvres dans un accrochage aux côtés de Kandinsky en février 1944. Exposition un peu désastreuse – la critique de la collaboration, est rétive à l’abstraction, cet « art dégénéré » – au vernissage pourtant très couru, on y croise même Picasso et Braque !

Mer et nuages, 1953 © Coll. part. /Courtesy Applicat-Prazan, Paris / Adagp, Paris 2023 / Ph.: D.R.
Une exposition suivie, le 7 avril, d’une autre, monographique cette fois, et annonçant comme un défi « Peintures abstraites. Compositions des matières », dans un local qui sert aussi de couverture à un membre… du Parti communiste clandestin ! Une première lueur : de Staël vend deux dessins. Son art d’alors est fait de couleurs sourdes et sombres qu’il pose, superpose, empâte en une sorte de recherche de conscience du matériau, en une abstraction résolue dans l’air de l’art d’alors (De la danse, 1946).
Remarié avec Françoise Chapouton, de dix ans sa cadette, il a peine à se remettre du décès de Jeannine et « restera à jamais inconsolable et inconsolé » écrira Daniel Dobbels². Le couple s’installe rue Gauguet dans ce qui sera, dès lors, le « point d’ancrage du peintre ». Un atelier haut de plafond témoin de toutes les étapes de son œuvre à venir. La couleur, d’abord timide (Eau de vie, 1948) devient plus franche, et remplace, peu à peu, la noirceur des œuvres précédentes.
Il élargit son champ, sort de son atelier, explore, travaille sur le motif, l’Île-de-France d’abord et ce mythique match de foot qui l’éblouit (Parc des Princes, 1952) et dont il expose sa vision au salon de Mai. Puis, c’est la Normandie (Ciel à Honfleur, 1952) et il « pousse » jusqu’en Provence. Au Lavandou, il peint sur la plage et s’émerveille – comme avant lui les Impressionnistes et les Fauves – de la lumière « vorace » et « fulgurante » du Sud (Arbre rouge ou Nature morte au tournesol, toutes deux datées de 1953), qui lui procure des sensations nouvelles : « À force d’être bleue, la mer devient rouge. » (lettre à Deys Sutton juin 1952).
Jeanne… la rencontre
Le paysage devient un credo dont la couleur s’empare et structure même ses tableaux. Son dessin aussi évolue, de simples croquis qui serviront de mémoire pour le passage sur toile en atelier. En quelques traits, il campe un paysage, une marine, une nature morte. La simplicité, l’essentiel… Il peint la quintessence des paysages dans ses « tableaux de marche », des petits formats plus adaptés à la peinture sur le motif. « Je suis dans un brouillard constant, ne sachant où aller, que faire […], bouffant ces paysages à longueur de journée de quoi en avoir une nausée définitive, ému malgré tout chaque fois. ». Comme beaucoup avant lui, la lumière du Midi l’attire. Installé provisoirement à Lagnes, il se rapproche de René Char qui l’introduit auprès d’une famille amie : les Mathieu. L’accueille est des plus chaleureux, il se sent de suite attiré, ébloui, par Jeanne, la fille de la famille. « Quelle fille, la terre en tremble d’émoi, quelle cadence unique dans l’ordre souverain » écrit-il à René Char le 20 juillet 1953. Elle devient son modèle… et plus. Mais Jeanne est, comme lui, mariée et mère de famille.
Le soleil, la lumière toujours… Ce se seront ceux de la Sicile où il se rend en août 1953. Une camionnette, la femme et les enfants, René Char, une amie et… Jeanne. Un road trip, avec comme acmé Agrigente et Syracuse. Des paysages d’où sortiront des œuvres d’une incroyable puissance chromatique et d’une radicale composition, plus tard, en atelier sur la base de croquis faits sur place. À la fin de cette année, de retour d’Italie, il rend visite à Douglas Cooper qui habite la Citadelle, un vaisseau de pierre au bout du piton rocher du village de Ménerbes. Déçu par la vie en ville, le peintre décide, sur ses conseils, d’acquérir Le Castellet à l’autre bout du village. Un petit château austère, délabré, ceint de remparts et entouré d’un espace à perte de vue. Il s’y installe dans un confort spartiate. Retapé et repeint, le rejoignent Françoise et les enfants.
Succès à New York… Mitigé à paris
Dès le début des années 50, sa touche s’affine. Des empâtements et des aplats au couteau du début, succède une matière plus lisse, presque des glacis, qui sonne un retour vers une figuration plus franche avec nus, paysages, bols, carafes, ateliers, et autres thèmes siciliens. « Il en résulte une œuvre libre et personnelle, qui manifeste la sensibilité toujours vive de ce peintre vis-à-vis de ce qui l’entoure » note Pierre Watt. Il ne façonne aucune perspective, les objets et lieux sont simplement silhouettés comme découpés et posés à plat sur des fonds sans relief (Le Bocal, 1953). La couleur et la forme comme quintessence du sujet. « Une surface qui ne subit en rien les déterminations d’un plan dans l’espace »
comme l’expliquait Léon Degand.³ Son art, plus que jamais, s’appuie sur la couleur, elle le façonne comme chez Matisse, pour lequel il vouait une véritable passion (Pots et pinceaux dans l’atelier, 1955).
Il travaille d’arrache-pied talonné par son nouveau galeriste new yorkais, Paul Rosenberg, qui envisage une grande exposition pour février 1954. Si le succès outre-Atlantique est assuré (la presse est dithyrambique), il n’en est pas de même à Paris, au Salon de Mai, où l’accueil est, ici, mitigé, dérouté sûrement par sa nouvelle manière et ses thèmes figuratifs. « Cette liberté l’a paradoxalement éloigné d’une certaine doxa moderniste où le renoncement à la représentation du réel jouait un grand rôle – décrypte Fabrice Hergott, le Directeur du Musée d’Art Moderne de Paris4 – Ce qui a conduit à ce qu’un certain public, le trouvant trop accessible, n’ait pas su mesurer son importance… Ainsi, la présence de Staël dans son histoire est-elle restée très modeste.». Il en est très affecté, allant jusqu’à douter de lui-même. Même Paul Rosenberg se permet de lui dire : « Il y a des gens pour regretter vos empâtements, trouvant la matière lisse du dernier lot moins frappante. ». Douglas Cooper, invité à venir voir ses dernières œuvres, va jusqu’à les trouver « trop décoratives » !
En septembre 1954, pour se rapprocher de Jeanne, il

Agrigente, 1954 © Coll. part. / Courtesy Applicat-Prazan, Paris / ADAGP, Paris, 2023 / Ph.: Annik Wetter
loue un appartement-atelier sur le front de mer à Antibes, mais à son grand dam, leur relation se dégrade « J’ai besoin de cette fille pour m’abîmer, je n’en ai pas besoin pour peindre et c’est grâce à elle que je travaille tant … » écrit-il à Herta Hausmann, une amie de Jeanne4. Retour à Paris en mars 1955 pour différentes visites. Il assiste à un concert au théâtre Marigny et en ressort « enrichi de nouvelles idées » qui donneront le sublime Concert, une œuvre maîtresse et monumentale, de six mètres de long, au fond rouge profond contrebalancé par ce piano noir et que vient équilibrer une contrebasse d’un ocre lavé. Ultime œuvre entamée le week-end du 12 mars… Week-end où il attendait la visite de Jeanne… Elle n’est pas venue. Lié à la tension extrême que lui cause ses doutes, cette absence d’une Jeanne qu’il sent s’éloigner, c’est de trop. Le 16 mars, le Concert à peine terminé, il se jette du haut de la terrasse de son atelier… Il laisse trois lettres, dont une à l’attention de son ami et galeriste Jaques Dubourg : « Je n’ai pas la force de parachever mes tableaux. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. De tout cœur »5.
___________________________________________
1/ Laurent Greilsamer. Le Prince foudroyé La vie de Nicolas de Staël. Éditions Fayard, 1998
2/ Daniel Dobbels. Staël. Hazan, 1994
3/ Léon Degand. Abstraction-figuration. Language et signification de la peinture. Éditions Diagonales/Cercle d’art , 1988
4/ In catalogue de l’exposition De Staël au Centre Pompidou, 2003
5/ In Catalogue raisonné de l’œuvre peint, Éditions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1997
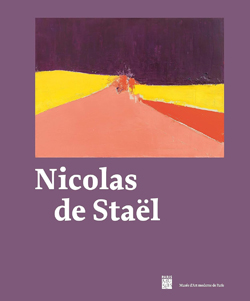
Musée d’Art moderne de Paris, 11 avenue du Président Wilson (16e).
À voir jusqu’au 24 janvier 2024
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30 pour les expositions temporaires seulement.
Accès :
Métro : ligne 9 – Arrêt Alma-Marceau ou Iéna
Bus : lignes 32 (Iéna), 42 (Alma-Marceau), 72 (Musée d’Art moderne), 80 (Alma-Marceau), 82 (Iéna) et 92 (Alma-Marceau)
Site de l’exposition : ici
Catalogue
Nicolas de Staël
Sous la direction de Charlotte Barat et Pierre Wat
Éditions Paris Musées
312 pages, 265 illustrations, 49 €
